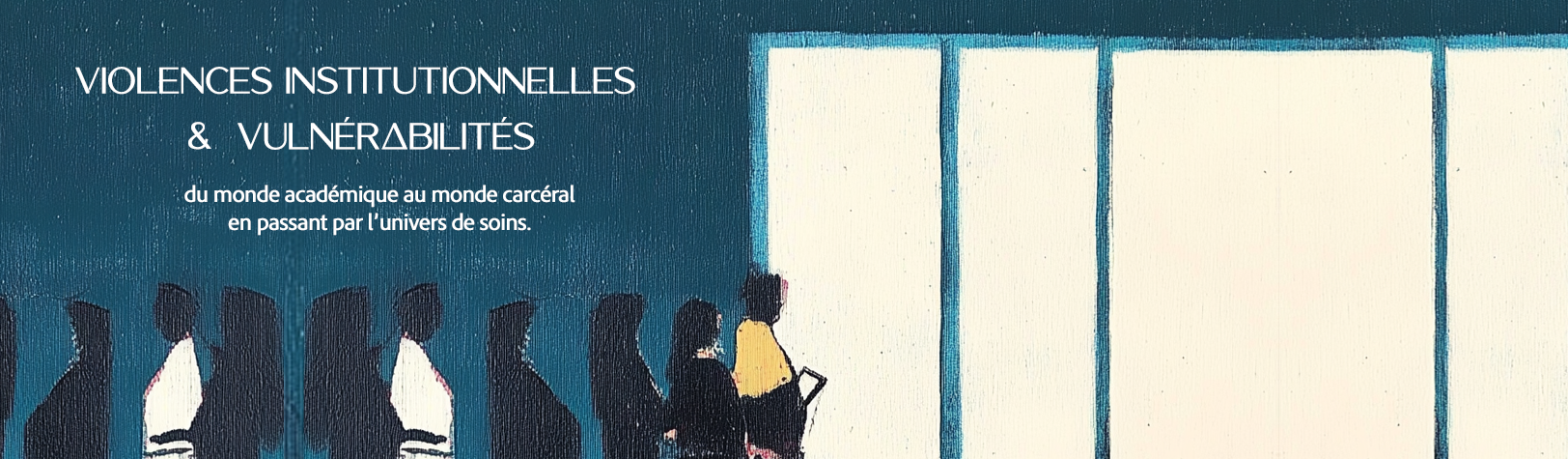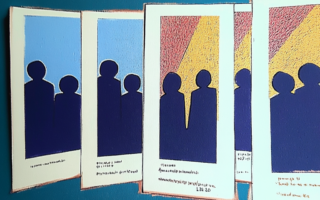La recherche DAS-EHPAD
DIMINUER L’ABSENTÉISME DES SOIGNANT.ES EN EHPAD _ RECOURIR AU SOUTIEN DES FAMILLES :
APPRÉHENDER LA DÉPRISE PROFESSIONNELLE DES SOIGNANT.ES À L’AUNE DE LA DE-́PRISE BIOGRAPHIQUE DES RÉSIDENT.ES…
MEIDANI Anita : Direction Scientifique
Enseigante-Chercheure UT2J
LISST CERS UMR 5193 CNRS
INSERM 1027
4 200 (EHPAD) et résidences autonomie & 430 000 soignant.es (DREES)
- Absentéisme de 10 %, soit 2 fois le taux d’absentéisme moyen des établissements privés du secteur de
la santé (communiqué parlementaire in 10e Baromètre de l’Absentéisme, 2018)
- Difficultés recrutements de « faisant- fonction » dont la qualification est insuffisante au regard du
profil des personnes à accueillir.
- Impact sur 1/. le budget des établissements (1p. d’absentéisme correspondant à 2,2 p. de la masse
salariale) 2/. la qualité des soins dispensés 3/. induit un stress accru pour les soignant.es qui exercent
des tâches pour lesquelles elles et ils ne sont pas suffisamment formé.es.
Ex. 2018, la CPAM de la Haute-Garonne estime à 5,8 millions d’euros le coût d’indemnisation des
arrêts de travail pour les 97 EHPAD de la Haute-Garonne (données internes non diffusées).
CONTEXTE
QUESTION DE DÉPART
L’interventionnisme social peut être plus iatrogène que l’absence de dispositif -> impératif de comprendre ce que « travailler dans un établissement de soins pour ’PA’ veut dire.
Notion du mandat gérontologique professionnel pour la discuter à l’aune de la de-́prise (Meidani, 2018 ; 2019 ; Meidani, Cavalli,
2018 ; 2019).
Question de départ : dans quelle mesure les dé-prises biographiques qu’expérimentent nos aîné.es placé.es en institutionpermettent- elles de comprendre les dé-prises professionnelles qui se manifestent dans l’absentéisme des soignant.es et en particulier des soignant.es de premières lignes en exercice dans les EHPAD : aides-soignant.es, infirmier.es, éducateur.rices. spécialisé.es, moniteur.rices éducateur.rices, assistant.es médico-psychologiques ?
Hypothèse : absentéisme des soignant.es une expression de dé-prise professionnelle en réponse avec d’autres formes de dé-prises biographiques en contexte de crise socio-sanitaire
Équipe de recherche pluridisciplinaire alliant sociologues et spécialiste en sciences de gestion, se propose d’examiner comment la question épineuse de l’absentéisme dans les institutions accueillant nos aîné.es a évolué durant la période récente avant, pendant et après(?) la crise sanitaire relative au COVID 19.
TRIPLE OBJECTIF
désigner d’une part, les catégories définitionnelles des problèmes rencontrés par les soignant.e.s en exercice dans ces établissements et les perceptions différentielles des risques
Identifier les moyens – mis à leur disposition ou à inventer -, pour traiter ces problèmes au quotidien éclairer les cadres pratique, éthique et moral constitués à partir des enjeux de l’accompagnement et de la prise en charge du grand âge prenant en considération le point de vue des résident.es et de leurs proches familiaux.les.
Le but ? Saisir les liens que les redéfinitions du mandat professionnel gérontologique entretiennent avec
l’absentéisme dans ces institutions.
À long terme, il s’agit de garantir (1) réduction de l’absentéisme en institutions, (2) amélioration de la qualité de soins dispensés auprès des résident.e.s, (3) développement de l’implication des familles de résident.e.s dans le cadre de la loi du 2 janvier 2002 du CASF
Modalités d’une recherche-action : élaboration d’un support d’accompagnement filmique pour ces familles lors du placement et du séjour d’un.e proche en structure d’accueil.
METHODES
Protocole d’enquête mixte alliant méthodologie qualitative et quantitative
Esprit comparatif et multi-site englobant 4 EHPAD, la CARSAT (EHPAD) et Geromouv.
Volet ethnographique/sociologique => monographies : 120 interviews auprès des directeur.rices, des
soignant.es, des aîné.es et des proches familiaux.les & 400 heures d’observations, équitablement
réparties entre les différents établissements.
Dispositif quantitatif => questionnaires élaborés par l’équipe des sciences de gestion, ciblant explicitement les soignant.es et la direction de différents établissements, diffusés avant et après une
large diffusion du film documentaire.
Objectif : évaluer l’évolution des indicateurs clés du côté des ressources humaines et financières afin
d’apprécier les effets des préconisations issues de notre travail.
- Dans un premier temps, un volet qualitatif
120 entretiens auprès des soignant.es de première ligne (pour moitié concerné.es par l’absentéisme), des aîné.es et des proches & complété par 400 heures d’observations des situations de soins, le tout équitablement réparti selon les EHPAD partenaires
=> Par EHPAD : 10E auprès des professionnel.es + 10E auprès des proches + 10E auprès des résident.es + 100H d’observation
– Objectif : identifier les problèmes rencontrés par les soignant.es des EHPAD & les moyens mobilisés pour y remédier. Expliciter le cadre moral d’exercice du travail de soins. Saisir les liens que les redéfinitions du mandat professionnel gérontologique entretiennent avec l’absentéisme et ses reconfigurations en période de crise sanitaire.
- Dans un second temps, un protocole quantitatif confirmatoire viendra compléter le volet qualitatif.
Première vague : enquête par questionnaires menée auprès des personnels des EHPAD (directeur.rices, soignant.es etc.) (N=100 à 150 pour moitié concernés par l’absentéisme).
Objectif : mesurer auprès des professionnel.les de santé les degrés de soutien perçu de la part des familles, leurs niveaux de motivation et d’engagement, ainsi que leur intention de quitter leur métier et/ou leur établissement. Analyser en parallèle des indicateurs financiers et le taux d’absentéisme des EHPAD.
- Dans un troisième temps
Seconde vague quantitative (N=100 à 150) sera réalisée après une large diffusion du film documentaire à destination des professionnel.les de santé, des aîné.es et de leurs proches.
Objectif : évaluer l’évolution des indicateurs clés, du côté des ressources, à la fois, humaines et financières, afin d’apprécier les premiers effets des préconisations issues de notre travail, des formations réalisées et de la diffusion de la production filmique.
A noter : ces deux volets quantitatifs mobiliseront des échelles validées en sciences de gestion & traitement des données à partir du logiciel SPSS et Mplus : application des analyses bi-variées et multifactorielles ainsi que des régressions linéaires.
METHODES (SUITE)
PERSPECTIVES
Recherche quasi-expérimentale qui prend appui sur un guide pratique et un film documentaire, conçu
comme des moyens de sensibilisation des professionnel.les des EHPAD, des aîné.e. et de leurs
proches familiaux.les.
Quadripôle originalité qui s’attaque à un angle mort de la recherche gérontologique et qui affirme son attachement à l’interdisciplinarité la mixité méthodologique, des dispositifs de recherche comparative (tant à un niveau spatial que temporel),
l’élaboration des pistes d’expérimentation susceptibles de remédier à un problème social majeur :
l’absentéisme des soignant.es dans les structures d’accueil des aîné.es en recourant au soutien et à
l’implication des familles.
PRISON-CO
Projet scientifique
Description du projet
Pourquoi étudier le cancer en prison ? La légitimité de l’objet de recherche :
Au cours des 40 dernières années, la population carcérale a presque doublé en France, pour atteindre actuellement environ 60 000 détenus. Beaucoup de ces personnes sont incarcérées dans un contexte de rupture des liens sociaux et d’accès aux soins. Par ailleurs, il est connu que l’expérience de l’incarcération est associée à un état de santé plus dégradé pour les détenus par rapport à la population générale et enregistrent des facteurs de risque de cancer tels que la consommation de tabac et d’alcool, l’hépatite C, le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), les infections par le papillomavirus humain (VPH). En outre, dans la littérature, les données ont montré que les taux d’incidence et de prévalence du cancer sont plus élevés que dans la population générale. Par exemple, les cancers du col de l’utérus, du sein, du poumon et colorectal sont surreprésentés dans la population carcérale.
De plus, les cancers incidents semblent être diagnostiqués à un stade tumoral plus avancé chez les détenus que dans la population générale. Les taux élevés de prévalence du cancer en prison interrogent les modalités d’accès des détenus à un parcours de soins spécialisés. À titre d’exemple, un article publié dans The New England Journal of Medicine a montré qu’après la libération de prison, le taux de mortalité lié au cancer chez les anciens détenus était de 50 % plus élevé que celui de la population générale (risque relatif (RR) 1,67, IC 95 % [1,2-2,2]) et que le cancer était la deuxième cause de mortalité chez les détenus actuels et les anciens détenus, après les maladies cardiovasculaires.
Quant aux douleurs liées au cancer, selon la littérature disponible, elles sont faiblement prises en compte en prison en raison, notamment, de la réticence des praticiens à prescrire de la morphine, du fait de leur crainte d’une mauvaise utilisation des médicaments et du « manque de fiabilité des patients ». Enfin, les prisons sont connues comme des environnements peu appropriés pour fournir aux détenus des soins de fin de vie cliniquement pertinents.